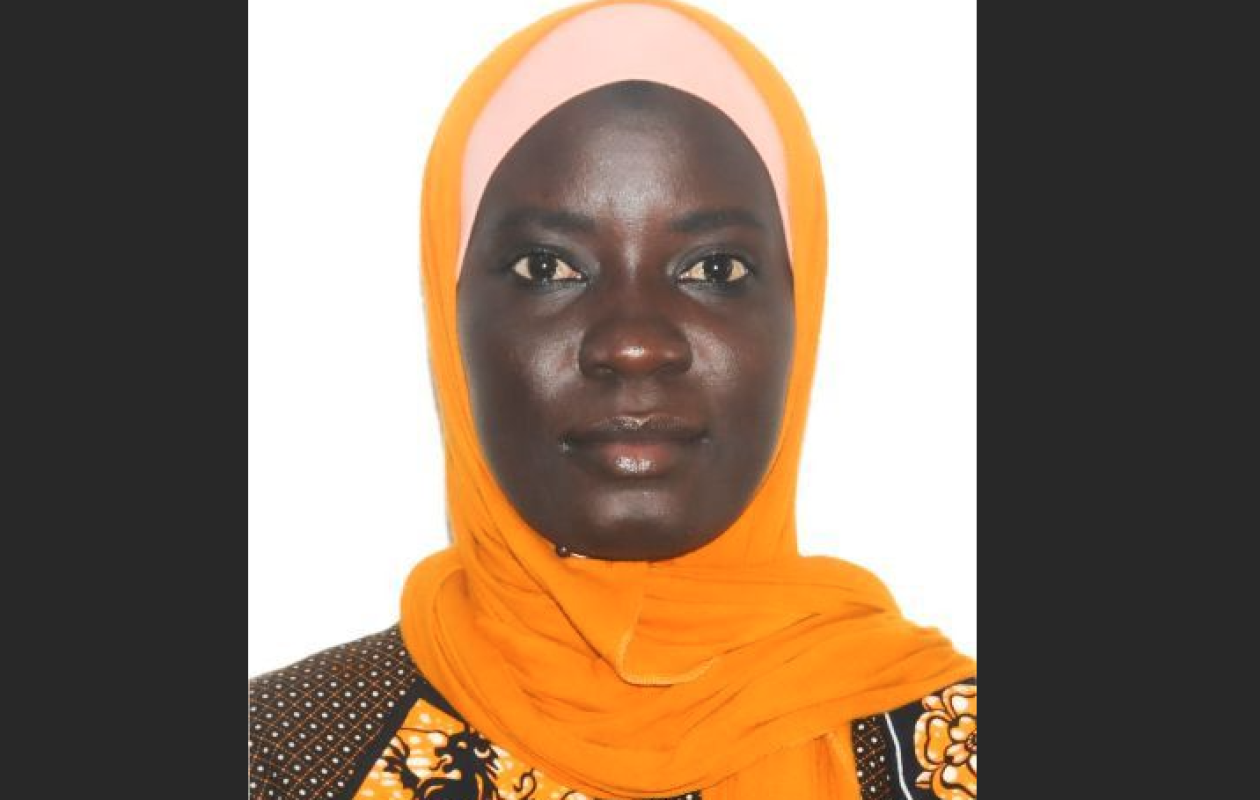
[Entretien] Oligopoles et concurrence : les pistes de Bineta Dia pour la CEDEAO
En Afrique de l’Ouest, quelques acteurs dominent encore de nombreux secteurs clés, limitant l’innovation et la dynamique économique régionale. Face à ces oligopoles, quelles stratégies les autorités de concurrence peuvent-elles déployer et comment harmoniser leurs actions au sein de la CEDEAO pour stimuler la croissance ? Bineta Dia, chercheuse à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et à l’Institut Africain de Politique Commerciale (IAPC), appréhende au micro de Seneweb ces enjeux complexes. Experte des régulations économiques et des dynamiques de marché, elle analyse à la fois les succès et les limites des autorités de concurrence au Sénégal et dans la région, tout en proposant des pistes pour un marché ouest-africain plus ouvert et équitable.
En Afrique de l’Ouest, les marchés restent souvent dominés par quelques acteurs puissants, ce qui limite la concurrence réelle. Quel rôle concret les autorités de concurrence peuvent-elles jouer pour casser ces oligopoles et dynamiser les marchés ?
Les autorités de concurrence ont un rôle central et multidimensionnel. Tout d’abord, elles peuvent mener des enquêtes et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes ou les abus de position dominante, en imposant des sanctions suffisamment dissuasives pour faire respecter les règles. Ensuite, elles contrôlent les concentrations, encadrant les fusions et acquisitions afin d’éviter la formation de monopoles ou d’oligopoles renforcés.
Au-delà de l’application stricte de la loi, elles ont également un rôle de plaidoyer pour la concurrence, en influençant les politiques publiques pour réduire les barrières à l’entrée, qu’il s’agisse de licences restrictives ou de subventions ciblées. Enfin, en favorisant un environnement concurrentiel équitable, elles soutiennent l’émergence des PME face aux acteurs dominants, stimulant ainsi la diversité et l’innovation sur le marché.
Par exemple, l’Autorité de la concurrence du Sénégal a récemment bloqué certaines fusions dans le secteur des télécoms afin d’éviter une concentration excessive du marché.
Selon la CEDEAO, moins de la moitié des États membres disposent d’une autorité de concurrence opérationnelle. Comment cette disparité freine-t-elle l’harmonisation régionale et la croissance économique ?
Cette disparité engendre plusieurs obstacles. Elle se traduit d’abord par un manque de coordination, rendant difficile la conduite d’enquêtes transfrontalières ou le partage d’informations. Ensuite, elle crée des distorsions de concurrence, puisque certaines entreprises exploitent les failles réglementaires dans des pays dépourvus d’autorités efficaces.
Enfin, elle constitue un frein à l’harmonisation régionale, ralentissant l’application du Règlement de la CEDEAO sur la concurrence et nuisant à l’objectif d’un marché intégré. Or, un marché régional cohérent est essentiel pour attirer des investissements et stimuler la croissance économique.
Des entreprises majeures du secteur agroalimentaire ou des télécoms au Sénégal et dans la région critiquent parfois la multiplication des enquêtes concurrentielles, estimant qu’elles ralentissent les investissements étrangers. Comment concilier protection du marché et attractivité économique ?
Il est possible de trouver un équilibre pragmatique. D’abord, les autorités doivent garantir prévisibilité et transparence, en publiant des lignes directrices claires sur les enquêtes et leurs délais. Ensuite, un dialogue régulier avec les investisseurs permet de rassurer les entreprises sur la stabilité du cadre réglementaire.
Par ailleurs, une approche proportionnée est essentielle. Les enquêtes doivent se concentrer sur les pratiques réellement nuisibles, sans alourdir inutilement les procédures. Une concurrence saine devient ainsi un facteur d’attractivité, en garantissant un marché ouvert, innovant et équitable, bénéfique à tous les acteurs économiques.
La collaboration transfrontalière entre autorités de concurrence est encore limitée. Quelles seraient les conditions nécessaires pour renforcer cette coopération et assurer une régulation efficace des marchés régionaux ?
Plusieurs conditions sont nécessaires. D’abord, un cadre juridique commun, harmonisé au niveau de la CEDEAO ou de l’UEMOA, est indispensable. Ensuite, il faut mettre en place des mécanismes de coopération, tels que des accords bilatéraux ou multilatéraux pour l’échange d’informations et la coordination des enquêtes.
Le renforcement des capacités constitue également un pilier : formations conjointes, partage de bonnes pratiques et assistance technique permettent d’améliorer l’efficacité des autorités. Enfin, les institutions régionales, notamment la Commission de la CEDEAO, ont un rôle clé de coordination et d’arbitrage.
Au Sénégal, quels sont les succès et les limites des interventions récentes de l’Autorité de la concurrence ? Peut-on parler d’un réel changement dans les pratiques commerciales ?
L’Autorité de la concurrence du Sénégal a enregistré plusieurs succès notables. Elle a pris des décisions emblématiques, telles que le blocage de certaines concentrations et des sanctions contre des ententes dans les marchés publics. Elle bénéficie également d’une visibilité accrue, et de plus en plus d’acteurs économiques sollicitent son expertise.
Cependant, des limites persistent. Les moyens restent limités, tant en ressources humaines qu’en financements, et l’exécution des décisions peine parfois faute de soutien judiciaire ou politique. Enfin, la culture de la concurrence reste encore faible : entreprises et administrations ne perçoivent pas toujours l’intérêt d’un marché concurrentiel.
Peut-on envisager une harmonisation complète des règles de concurrence au niveau de la CEDEAO, ou est-ce utopique compte tenu des divergences économiques et politiques entre États ?
L’harmonisation n’est pas utopique, mais elle nécessite certaines conditions. Il faut d’abord une volonté politique forte, les États devant accepter de céder une part de souveraineté réglementaire. Une approche progressive est également recommandée : commencer par des règles minimales communes avant d’évoluer vers une harmonisation plus poussée.
Enfin, l’appui technique et financier des partenaires au développement est indispensable pour accompagner les réformes. L’expérience de l’UEMOA démontre qu’une harmonisation est réalisable, et la CEDEAO pourrait s’en inspirer tout en tenant compte des spécificités nationales.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté :
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter ou TikTok pour l'afficher automatiquement.